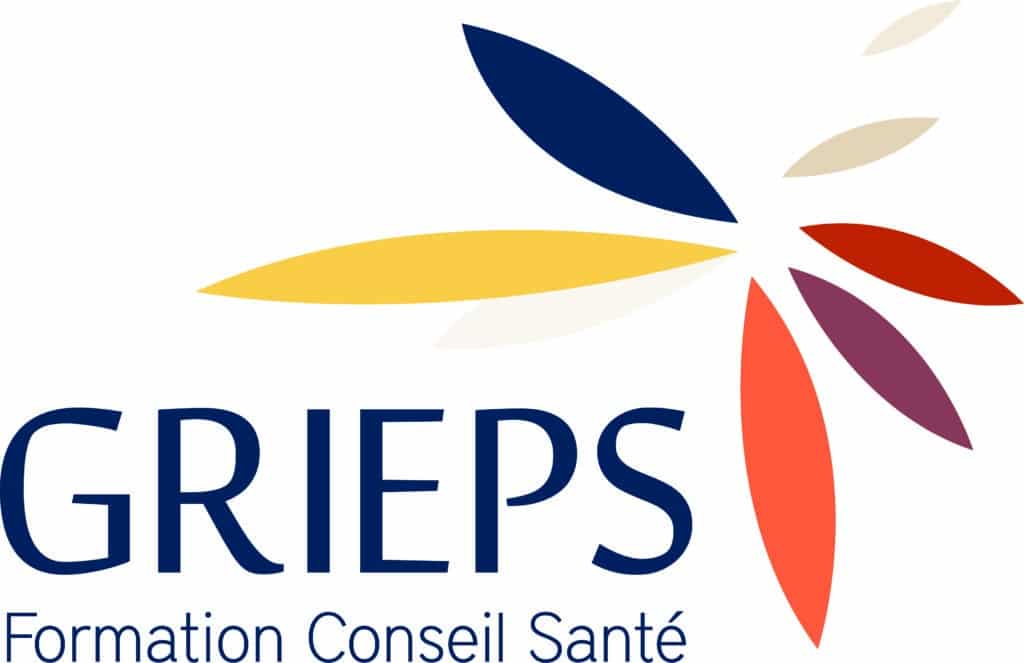Réforme infirmière : un tournant historique
Une juriste fait le point sur la loi du 27 juin 2025 et ses implications pour la profession
Le cadre législatif encadrant la profession infirmière n’avait pas connu de réforme majeure depuis 2002.
En plus de vingt ans, la pratique a profondément évolué : essor des infirmiers en pratique avancée (IPA), protocoles de coopération sanitaire, et besoin croissant d’adapter l’organisation des soins à la désertification médicale.
La loi du 27 juin 2025 constitue une première étape importante.
Pour être pleinement applicable, elle devra être prolongée par plusieurs décrets encore à paraître. Voici ce qu’elle modifie.
 Une autonomie renforcée
Une autonomie renforcée
Deux actes majeurs sont désormais reconnus par la loi :
- La consultation infirmière
- Le diagnostic infirmier
Si le diagnostic infirmier existait déjà en pratique, la consultation infirmière, elle, ouvre la voie à un accès direct aux infirmiers, dans le cadre de leur rôle propre — dans la continuité de la loi RIST I — à l’instar des kinésithérapeutes.
 Des droits de prescription élargis
Des droits de prescription élargis
Les infirmiers se voient accorder le droit de prescrire certains produits de santé et examens complémentaires, selon une liste fixée par arrêté.
Ils pouvaient déjà re-prescrire certains médicaments (comme les contraceptifs) et pratiquer certains vaccins en rôle propre, sans intervention médicale.
Concernant le rôle prescrit (délégué par les médecins), l’accès direct aux infirmiers devrait d’abord être testé sous forme d’expérimentation.
 Valorisation des spécialités et des missions spécifiques
Valorisation des spécialités et des missions spécifiques
La loi reconnaît désormais plusieurs spécialités infirmières et précise leurs champs d’action.
Infirmiers coordinateurs et infirmiers scolaires
Le statut d’infirmier coordinateur en EHPAD et celui d’infirmier scolaire sont officiellement reconnus comme spécialités infirmières.
Le décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 vient clarifier le rôle des coordinateurs, renforçant leur place dans la gestion et la coordination des soins.
Infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire et de puériculture
Les infirmiers anesthésistes (IADE), de bloc opératoire (IBODE) et de puériculture (IPDE) peuvent désormais exercer en pratique avancée.
Un premier arrêté, publié le 5 septembre 2025, vise spécifiquement les IADE.
Il précise les conditions d’accès à la pratique avancée :
- Être titulaire du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste,
- Ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation,
- Ou encore du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-anesthésiste.
Cas particuliers
L’arrêté prend aussi en compte :
- Les infirmiers disposant d’une autorisation individuelle (article L. 4311-4),
- Et ceux ayant fait une déclaration préalable (article L. 4311-22) précisant leur fonction d’IADE.
Les missions des IADE
- En préopératoire : leur rôle dans l’évaluation est renforcé. Ils pourront mener certaines consultations et prescrire des bilans ou examens ciblés.
- En SSPI et en réanimation : ils disposeront d’une autonomie élargie, avec la possibilité d’ajuster certains traitements directement.
- En urgence vitale : leur expertise, déjà reconnue, est désormais consolidée par un cadre réglementaire clair.
Ces évolutions traduisent une reconnaissance officielle du haut niveau de compétence des IADE et annoncent un mouvement similaire à venir pour les autres spécialités.
 Encadrement des pratiques
Encadrement des pratiques
Dans le prolongement de la logique de certification et de sécurisation des compétences, la loi fixe désormais à six ans la durée d’inactivité au-delà de laquelle un infirmier doit faire évaluer ses compétences avant de reprendre son activité.
« Si l’autorité compétente constate une insuffisance professionnelle, elle peut imposer des mesures d’accompagnement ou de formation avant toute reprise d’activité. »
Ce mécanisme garantit la qualité et la sécurité des soins tout en valorisant la compétence continue.
 Et maintenant ? Des questions de fond
Et maintenant ? Des questions de fond
Les textes d’application sont encore attendus, mais plusieurs interrogations majeures se posent déjà :
- L’élargissement du rôle propre et délégué pourrait intégrer certains actes aujourd’hui encadrés par les protocoles sanitaires nationaux, simplifiés en septembre 2025. Jusqu’où iront ces transferts ?
- Si de nouveaux actes sont intégrés, cela nécessitera une réingénierie complète de la formation infirmière.
- Le statut et la rémunération devront évoluer : la prise en charge d’actes actuellement médicaux exige une reconnaissance financière adaptée.
Par exemple, les IPA anesthésistes à l’hôpital accepteront-ils de rester sur une grille indiciaire proche de celle des cadres de santé ?
Des négociations sont en cours. - Enfin, la question de la formation aux nouveaux actes reste entière : aujourd’hui, les professionnels se forment souvent “sur le tas”, sans dispositif national d’appui.
Le projet de décret relatif aux actes infirmiers, dévoilé récemment, élargit bien le rôle des professionnels, mais ne précise pas encore assez les modalités de mise en œuvre.
Conclusion : une réforme fondatrice mais encore inachevée
Cette réforme marque une étape décisive dans la reconnaissance de la profession infirmière.
Elle renforce son autonomie, valorise ses spécialités, et consacre sa compétence clinique.
Mais elle appelle désormais :
- une mise en œuvre réglementaire claire,
- une réforme de la formation à la hauteur des nouvelles missions,
- et une reconnaissance statutaire et salariale adaptée à la montée en responsabilité.
La profession infirmière entre ainsi dans une nouvelle ère : celle d’une profession médicale à compétence limitée, au carrefour du soin, du diagnostic et de la coordination — pilier incontournable du système de santé de demain.