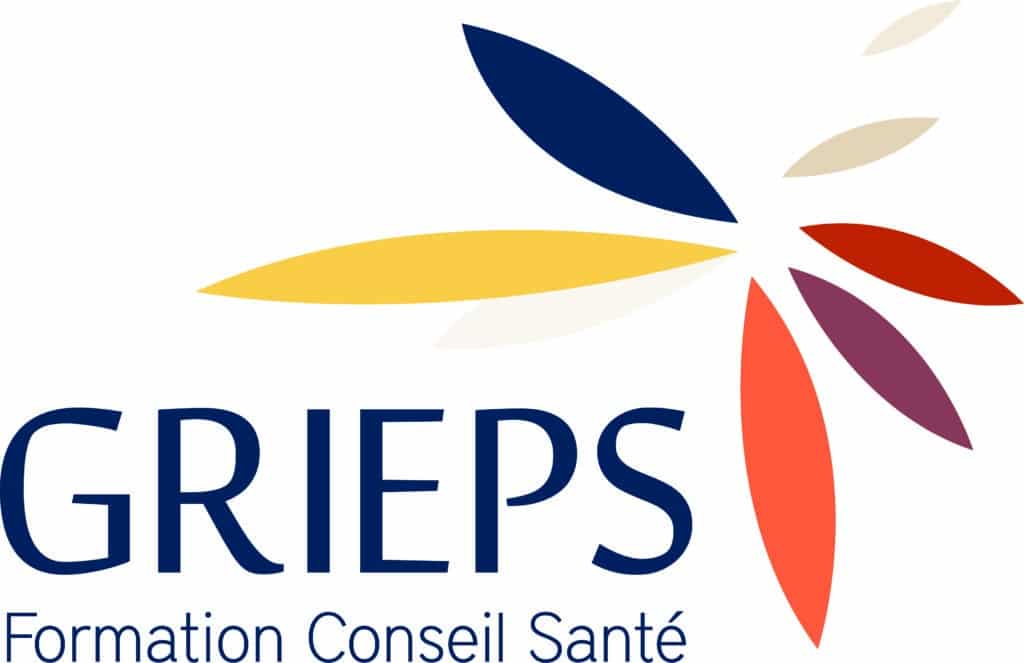Infirmier Ressource Douleur (IRD)
Compétences visées
Exercer des missions d’Infirmier Ressource Douleur (IRD) dans un parcours de soin et de santé.
Objectifs et contenus
Participer aux consultations de première ligne d’évaluation et de traitement de la douleur
- Le contexte réglementaire : parcours patient douleur, compétences infirmières.
- La consultation infirmière.
- La consultation pluridisciplinaire.
- La consultation téléphonique.
Formaliser l’activité Infirmier Ressource Douleur (IRD)
- L’évaluation de l’état de santé de patients douloureux en relais de consultations médicales ou de consultations de première ligne.
- L’analyse des données du dossier du patient.
- L’entretien visant à recueillir l’anamnèse du patient dans une approche bio-psycho-sociale.
- L’évaluation et les caractéristiques de la douleur, les traitements non-médicamenteux et médicamenteux en cours.
- L’examen clinique adapté à la situation du patient dans son champ de compétences.
- L’élaboration d’hypothèses, de conclusions cliniques et d’un diagnostic infirmier dans son champ de compétences.
- La formalisation de données recueillies, la rédaction du bilan de l’état de santé et de la situation du patient destiné à l’équipe pluridisciplinaire.
Participer à l’organisation du processus de soins et de santé du patient douloureux
- La mise en œuvre du projet thérapeutique en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, le patient et son entourage.
- La conception et la mise en œuvre des actions de prévention et d’éducation.
- L’analyse du parcours du patient : risques potentiels et améliorations possibles.
- La coordination des interventions dans le cadre du parcours de soins.
- La continuité des soins.
Clarifier les missions du référent douleur
- Les missions et les activités spécifiques.
- La différenciation et l’articulation avec l’Infirmier Ressource Douleur (selon le référentiel de la SFETD).
- Les activités qui s’y rapportent et les compétences requises.
- La politique de lutte contre la douleur au sein de l’établissement : projet du CLUD.
- La participation aux évaluations de la qualité.
- La contribution à l’élaboration de protocoles : apport méthodologique.
Renforcer les compétences nécessaires à la mission de référent
- Le positionnement de leadership clinique.
- La mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles.
- L’animation d’un groupe de travail et les principes de la conduite de réunion.
- Le montage et la conduite d’une séquence de formation : intentions et déroulement pédagogique.
- La conduite de recherche documentaire et bibliographique.
- La contribution à des études et à des travaux de recherche dans le champ de la douleur.
- L’élaboration d’un plan d’actions et de sa grille d’impacts au regard des missions.
Méthodes
- Quiz d’autoévaluation.
- Apports théoriques.
- Vignettes cliniques/parcours patient.
- Élaboration d’outils.
Personnes concernées
Infirmier, Infirmier en Pratique Avancée et Cadre de Santé, positionnés ou souhaitant avoir une activité de Référent/Infirmier Ressource Douleur (IRD).
Valeur ajoutée de la formation
Cette formation valorise le partage d’expertise relative aux activités et aux compétences de l’Infirmier Ressource Douleur (IRD). Elle aborde les 4 catégories d’activités : consultations infirmières, démarches cliniques, formation et recherche, activités afférentes aux soins. La démarche participative et de co-construction en équipe (méthodologie projet) est un des points forts de cette formation.
À noter
Les points forts de cette formation sont
- Valorisation et partage d’expertise relative aux activités et compétences de l’Infirmier Ressource Douleur (IRD).
- Les quatre catégories d’activités : consultation infirmière, démarches cliniques, formation et recherche, activités afférents aux soins.
- Démarche participative et de co-construction en équipe (méthodologie projet).
Cette formation s’appuie sur les recommandations et référentiels suivants
- Article L1110-5 du code de la santé publique : « … toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte… ».
- Article R6164-3 – alinéa 4 – du code de la santé publique : « La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : […] : La prise en charge de la douleur ».
- Article R6144-2 – alinéa 4 – du code de la santé publique : « La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : […] 4° La prise en charge de la douleur ».
- Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en médecine ambulatoire. Paris : ANAES; 1999.
- Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Evaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale. Paris : ANAES; 2000.
- Haute Autorité de Santé. Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient. Consensus formalisé. Argumentaire. Saint-Denis La Plaine : HAS; 2008.
- Haut conseil de la santé publique. Evaluation du plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006¬2010. Paris: La Documentation française; 2011.
- Société française d’étude et de traitement de la douleur. Livre blanc de la douleur 2017. Etat des lieux et propositions pour un système de santé éthique, moderne et citoyen. Paris: SFETD; 2017.
- Haute Autorité de Santé. Modèle de plan personnalisé de coordination en santé. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2019.
- Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD). Infirmier ressource douleur. Référentiel d’activités et de compétences; 2020.
- Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain 2020; 161(9):1976-82.
- Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD). Appliquer la reconnaissance d’une pratique avancée à l’exercice de l’infirmier ressource douleur (IRD) au sein des SDC; 2021.
- HAS ; Janvier 2023. Parcours de santé d’une personne présentant une douleur chronique.
- Guide HAS (janvier 2023). Parcours de santé d’une personne présentant une douleur chronique.
- Argumentaire HAS (janvier 2023). Parcours de santé d’une personne présentant une douleur chronique.
- HAS • Certification des établissements de santé pour la qualité des soins • Version 2025.
Pré-requis
Dispositif d'évaluation
- Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
- Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l’intermédiaire d’un outil proposé par le formateur (quiz de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation…).
- La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide d’un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le programme de formation, les méthodes d’animation et la qualité globale de l’intervention.
- A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d’analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans d’action, préfiguration d’un plan d’amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d’impact…).
FORMATION INTER & INTRA
Référence
ECTDO06A
Durée
3 jours
Tarif
1125€ net de taxe
NOS SESSIONS
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
ESNAULT Nadine
Formations qui peuvent vous intéresser
Prévenir, évaluer et soulager la douleur
Savoir prévenir, évaluer et soulager la personne douloureuse dans une situation de soins complexes.
2 jours
Évaluer et prendre en charge la douleur – Parcours e-learning
Apprendre à évaluer et prendre en charge la douleur, faire un suivi efficace, réévaluer l’intensité douloureuse après l’administration d’un antalgique, noter les résultats, documenter et tracer la douleur dans le dossier patient.
2 heures
Douleur induite par les soins
Savoir anticiper la douleur induite par les soins et mettre en œuvre les stratégies de prise en charge et des outils consensuels d’aide à la prise en charge.
2 jours