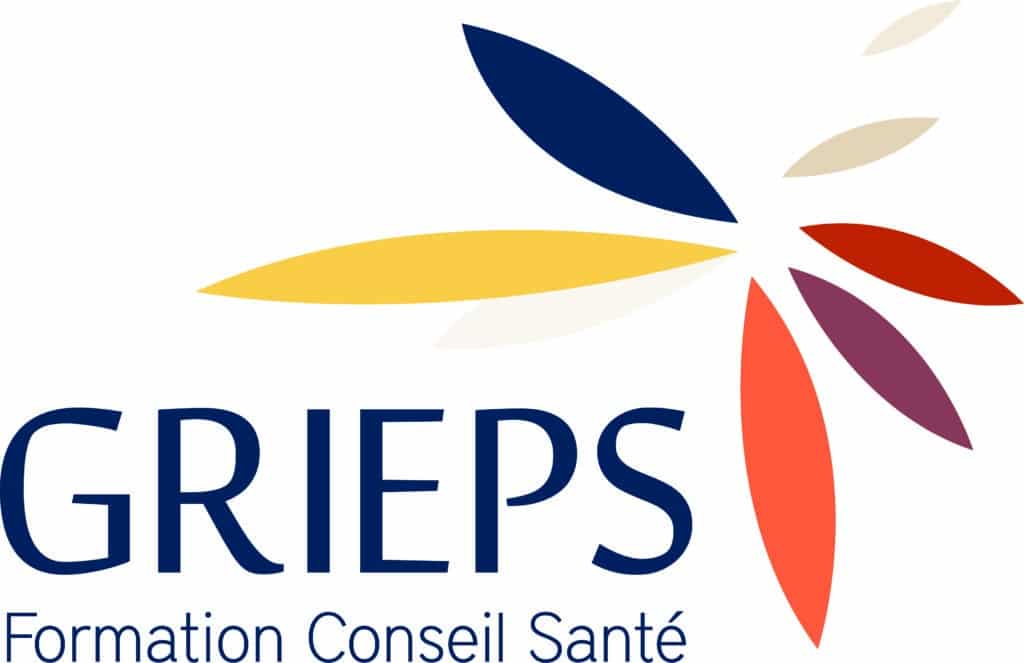Travailler, pour une partie ou pour la totalité de ses horaires, soit le soir (entre 20h00 et minuit), soit la nuit (entre minuit et 05h00), soit le samedi ou le dimanche, relèvent de travail en horaires atypiques. Près de 44% des salariés, soit 10,4 millions de personnes, travaillaient en 2017 au moins une fois par mois à un horaire atypique (Dares, juin 2018). Le secteur social et médicosocial est largement concerné par ces horaires atypiques ayant l’obligation d’assurer la continuité de la vie sociale et la permanence des soins. Ces horaires ne sont pas sans risques pour la santé des personnes qui y sont soumises.
Continue readingL’accès aux savoirs chez les infirmiers psychiatriques : une histoire riche d’enseignements
Une petite centaine d’heures. Voilà ce qu’il reste aujourd’hui dans le programme de formation initiale de l’enseignement théorique psychiatrique auprès des infirmiers. Un paradoxe remarquable au regard du contexte de la santé mentale sur le territoire. En effet, les troubles psychiques et les pathologies mentales affectent un individu sur cinq en France. Sur le plan épidémiologique ils occupent, en termes de prévalence, la troisième place juste derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. Aujourd’hui, dans le dispositif de soin actuel tourné vers l’ambulatoire, les infirmiers représentent des acteurs majeurs et la pénurie exponentielle de psychiatres majore encore l’importance de leur rôle et de leur fonction. Problème de taille, à contrecourant des besoins croissants de connaissances, depuis la fusion des diplômes « DE » et « ISP » (infirmier de secteur psychiatrique) en 1992, l’accès aux savoirs propres à la spécialité se heurte à des entraves quantitatives et qualitatives. Un retour dans le passé s’avère riche d’enseignements car il témoigne d’un phénomène de récursivité historique inquiétant contre lequel la formation professionnelle constitue un dernier rempart.
Continue readingLes interventions au domicile en psychiatrie (VAD et HAD)
« Habiter quelque part, c’est déjà s’habiter soi-même »
Depuis plusieurs années, les projets d’amélioration du système de santé français insistent sur la nécessité d’un virage ambulatoire qui permettrait d’éviter l’engorgement des établissements mais aussi, et surtout, de proposer aux personnes un accompagnement dans leur environnement familier, moins déstabilisant qu’une hospitalisation. Dans le cadre du Ségur de la santé dernièrement initié mais qui s’inscrit dans la continuité du projet « Ma Santé 2022 » proposé par le président de la république, le premier ministre a réaffirmé cette priorité. En outre, la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19 et ses conséquences négatives (ruptures de soin, difficultés pour accéder aux structures, recrudescence des suicides, etc.) montre les limites d’un système centralisé et la nécessité d’un accompagnement de proximité.
Continue readingSe former en e-learning pour « dispenser l’ETP » et « coordonner, piloter un programme d’ETP » : c’est possible, avec le GRIEPS !
En France, le nombre de personnes porteuses de maladie chronique est en constante augmentation. 10,7 millions de personnes sont prises en charge pour une maladie chronique au titre du dispositif « Affection Longue Durée » (ALD). En réalité, ce sont 20 millions de personnes (soit 35% de la population couverte par le régime général de l’assurance maladie) qui ont eu recours à des soins liés à une maladie chronique si l’on se réfère au rapport « charges et produits » de 2019 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM). La prévalence des maladies chroniques est en hausse constante. Entre 2011 et 2017, les admissions en « ALD liste », au régime général, sont passées de +869 000 à +1 680 300. Sur la période 2015-2020, les admissions devraient augmenter de 20% pour certaines maladies.
Continue reading2020 : Du noir au blanc, puis à la couleur. La tenue de l’infirmière raconte l’histoire d’une profession
2020, année internationale du personnel infirmier et de la sage-femme, commence et nous incite à nous pencher sur l’évolution de ces métiers du soin qui ont, au fil des années et des siècles, laissé une empreinte forte dans les représentations de la population. L’infirmière, a porté l’image de la dévotion tout aussi bien que celle de la légèreté avec un regard parfois sexiste sur ce métier très féminisé. Si l’on évoque la tenue de l’infirmière, une des représentations les plus ancrée est qu’elle ne porte rien sous sa petite blouse sexy ! On est bien loin de la réalité ! Saviez-vous que les premières infirmières portaient de longues blouses noires ?
Continue readingPatients ou résidents « errants », enjeux entre libertés individuelles et sécurisation
Être « admis » en Unité Protégée aujourd’hui, dans un EHPAD, signifie qu’une personne souffre de troubles cognitifs associés à des « troubles du comportement », dont celui de sortir de façon inopinée de l’établissement et de se perdre à l’extérieur. Il s’agit là d’un trouble du comportement moteur aberrant (déambulation excessive). Face à ce risque, l’attitude classique consiste le plus souvent à un enfermement de la personne afin de la maintenir dans un milieu sécurisé. Cette problématique mérite d’être interrogée pour faciliter une distanciation et éclairer autrement les difficultés des professionnels.
Continue reading2020, Être infirmier(ère) en psychiatrie : un hymne à la créativité au service des médiations thérapeutiques et éducatives
2020 a été déclarée « Année des Infirmières et des Sages-Femmes » par l’OMS. Dans son allocution, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré ces deux professions « inestimables pour la santé des personnes, partout dans le monde. Sans infirmières et sages-femmes, nous n’atteindrons pas les objectifs de développement durable ni la couverture sanitaire universelle. […] 2020 sera consacrée à mettre en lumière les énormes sacrifices et contributions des infirmières et des sages-femmes à la qualité des soins […] » (espaceinfirmier.fr).
Continue readingLa dépendance nosocomiale (Iatrogène)
La prise en soin des personnes âgées à l’hôpital est une priorité de santé publique, politique et économique ; les chiffres sont éloquents : chaque année en France, 3 millions de personnes âgées de 70 ans et plus sont hospitalisées, soit un taux d’hospitalisation de 409 personnes pour 1 000, contre 191 sur l’ensemble de la population. Cette population âgée enregistre des durées moyennes de séjour plus élevées que les autres : à partir de 85 ans, elles sont proches de 10 jours, soit le double de celles des adultes de moins de 64 ans (groupe Colisée 2018).
Continue readingLa RSE est donc morte avant d’avoir vécu ? Décryptage
Ces derniers mois les articles se succèdent et se ressemblent ! Le message : « la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), c’est dépassé. Il faut passer à autre chose ! ». Elle est parfois audacieusement présentée comme un simple effet de mode. Pourtant les enjeux sont colossaux. Que se cache-t-il derrière ce rejet ? Peut-on concevoir une continuité, quitte à employer d’autres mots ?
Le principe du rétroviseur, c’est bien connu : Regarder ce qui se passe derrière pour mieux anticiper ce qui se passera devant.
Que se passe-t-il derrière ? En d’autres termes, comment en est-on venu à former le concept de RSE ?
Patient debout : le défi du parcours ambulatoire
Quelle personne venant pour une chirurgie ambulatoire, ne s’est pas demandé pourquoi elle se retrouvait alitée de longues minutes sur un brancard, à deux pas de la porte du bloc, grelottant dans une tenue papier trop grande, scrutant le plafond blanc dans une atmosphère de stress préopératoire ?
Continue reading